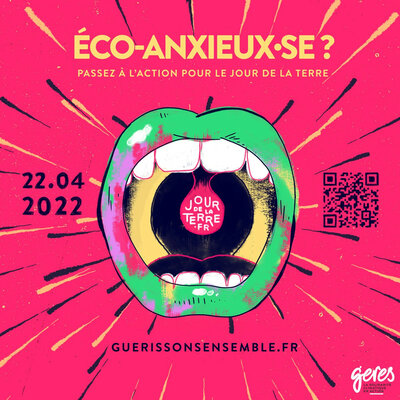Qu’est-ce que le Jour du dépassement ?
Le Jour du dépassement de la Terre (Earth Overshoot Day en anglais) correspond au moment de l’année où l’humanité a épuisé le budget annuel de ressources renouvelables de la planète. Chaque année, l’ONG Global Footprint Network calcule cette date en comparant l’empreinte écologique de l’humanité (notre consommation de ressources et émissions) à la biocapacité de la Terre (ce que les écosystèmes peuvent produire et absorber sur l’année). Tant que nous n’avons pas dépassé cette limite, nous vivons des « intérêts » que la Terre génère ; une fois la date passée, nous entamons le capital naturel.
« Nous coupons des arbres qui ne pourront pas repousser [...] nous émettons du carbone qui ne pourra pas être absorbé », résume Jean Burkard, directeur du plaidoyer du WWF France, pour illustrer le concept de dépassement.
En 2025, nous utilisons ainsi les ressources environ 80 % plus vite que la planète n’est capable de les régénérer, ce qui équivaut à consommer les ressources de 1,8 Terre en un an.
Une tendance de plus en plus précoce
Évolution de la date du Jour du dépassement global de 1971 à 2025. Chaque barre représente la date à laquelle les ressources annuelles ont été épuisées : en bleu, la part de l’année soutenable avec “une Terre” (consommation égale aux ressources disponibles), en rouge la période de dépassement au-delà des capacités planétaires.
Par exemple, au début des années 1970, le dépassement survenait encore vers la toute fin de l’année (le 29 décembre 1971 d’après les estimations). En l’an 2000, il avait déjà glissé au 16 septembre. En 2025, c’est dès la fin du mois de juillet que nous épuisons le budget écologique annuel de la Terre, du jamais vu à l’échelle historique récente.
Ce décalage progressif vers une date de plus en plus avancée illustre l’accélération de notre empreinte écologique au fil des décennies. Depuis le milieu des années 2000, le Jour du dépassement mondial stagne dans une fenêtre située entre fin juillet et début août, sans réel recul durable. Ce qui signifie que malgré les efforts ponctuels, nous n’avons pas encore réussi à renverser la tendance de fond. La seule exception notable a eu lieu en 2020, lorsque la date avait été repoussée jusqu’au 16 août sous l’effet des confinements et du ralentissement économique liés à la pandémie de Covid-19. Ce bref répit n’a toutefois pas duré : dès 2021, le dépassement est retourné à début août, puis fin juillet en 2023 et 2024. La persistance du dépassement dans ces eaux-là signifie que chaque année, environ cinq mois d’activité humaine se font désormais aux dépens du capital naturel de la planète.
Des ressources sous pression et des impacts alarmants
Une telle surconsommation mondiale des ressources entraîne déjà des conséquences écologiques concrètes.
D’après le WWF, la déforestation, l’érosion des sols, la perte de biodiversité ou encore l’accumulation de CO₂ dans l’atmosphère dues à nos excès se traduisent par des phénomènes graves :
- multiplication des événements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, mégafeux),
- baisse des rendements agricoles observée dans certaines régions du globe.
En outre, le dépassement écologique alimente des problèmes économiques et sociaux : il exacerbe l’insécurité alimentaire et la volatilité des prix de l’énergie, et peut attiser tensions et conflits dans un monde où les ressources se raréfient. En 2023, par exemple, plusieurs pays ont été confrontés à des pénuries d’eau ou d’électricité et à une inflation accrue des denrées liées en partie à ces pressions sur les ressources naturelles.
Parmi les ressources critiques, l’eau douce illustre bien la situation de dépassement. On pense souvent à l’eau du robinet, mais en réalité chaque Français mobilise en moyenne 500 litres d’eau par jour en incluant l’eau “invisible” nécessaire pour produire les biens et aliments qu’il consomme. C’est plus de trois fois notre usage d’eau domestique direct. Près de la moitié de cette empreinte hydrique provient de notre alimentation, et une grande part de cette eau est prélevée dans des zones déjà sujettes au stress hydrique ou à la surexploitation. Nos modes de vie en Europe ont donc un impact direct sur des réserves en eau lointaines, contribuant à aggraver la pénurie dans des régions arides ou vulnérables.
Ce constat met en lumière l’interdépendance planétaire : en dépassant les limites écologiques, nous déstabilisons les équilibres naturels dont dépendent l’agriculture, la santé et la sécurité de millions de personnes.
Des solutions pour repousser le jour du dépassement
Face à ce constat préoccupant, des solutions existent pour réduire notre empreinte et reculer le Jour du dépassement dans le calendrier. Le Global Footprint Network parle de #MoveTheDate (“déplacer la date”) et souligne que corriger ce « méga-déséquilibre » écologique apporterait des bénéfices à long terme pour tous. Le WWF France appelle ainsi à transformer en profondeur nos usages et nos systèmes de production, notamment en réformant l’agriculture et l’alimentation, afin de repousser durablement cette date critique plutôt que de la voir avancer chaque année.
Concrètement, les leviers d’action identifiés couvrent plusieurs domaines clés :
- Énergie : accélérer la transition vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin de réduire drastiquement les émissions de CO₂. Par exemple, diviser par deux les émissions liées aux combustibles fossiles repousserait la date mondiale d’environ 3 mois.
- Alimentation et agriculture : adopter une alimentation plus durable (moins de produits d’origine animale, plus de produits locaux) et promouvoir des pratiques d’agroécologie pour diminuer l’empreinte sur les terres et l’eau. Une évolution des régimes alimentaires vers moins de viande pourrait à elle seule réduire d’au moins 30 % les émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation.
- Villes et transports : concevoir des villes plus soutenables, avec des infrastructures sobres en énergie et des transports propres. Le développement des mobilités douces (transports en commun, covoiturage, vélo…) permet de diminuer la dépendance aux énergies fossiles et de limiter la pollution liée aux déplacements.
- Protection des écosystèmes : renforcer la préservation des forêts, des océans et autres écosystèmes naturels. Lutter contre la déforestation et la conversion des milieux (par exemple en protégeant les zones forestières et humides) aide à maintenir la capacité de la Terre à absorber le carbone et à fournir des ressources sur le long terme.
- Économie circulaire et sobriété : encourager les modèles d’entreprises et de consommation plus circulaires et responsables. Certaines entreprises démontrent qu’il est possible de se développer tout en réduisant leur empreinte écologique, en innovant dans des solutions bas-carbone et en minimisant le gaspillage. De même, chaque citoyen peut contribuer en modérant sa consommation et en optant pour des biens et services à moindre impact.
En repoussant la date du dépassement, l’objectif est de retrouver un équilibre viable où nos besoins n’excèdent pas les capacités de la Terre. Des initiatives positives émergent un peu partout : villes s’engageant vers le zéro carbone, entreprises adoptant l’économie circulaire, politiques publiques en faveur des énergies propres ou de la reforestation…
Si ces efforts se multiplient et s’intensifient, ils pourraient à terme mettre fin à l’”overshoot” et faire en sorte que la Journée du dépassement tombe le 31 décembre, c’est-à-dire que l’humanité vive enfin dans les limites d’une seule planète. L’enjeu est vital, car il en va de la préservation du capital naturel dont dépend notre avenir commun. Chaque pas vers la durabilité compte pour retarder l’échéance et transmettre aux générations futures une planète vivable et résiliente.
| 📌 Thématiques | 🌍 Informations clés à retenir |
|---|---|
| Date du dépassement en 2025 | 📅 24 juillet 2025 |
| Comparaison avec 2024 | 🗓️ 8 jours plus tôt (accélération alarmante) |
| Définition du concept | 🌱 Moment où l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre produit en un an. |
| Évolution historique | ⏳ 29 décembre en 1971, 16 septembre en 2000, fin juillet depuis 2023 |
| Conséquences écologiques | 🌳 Déforestation, perte biodiversité, stress hydrique, augmentation phénomènes climatiques extrêmes |
| Conséquences socio-économiques | 🚨 Insécurité alimentaire, conflits liés aux ressources, inflation des prix de l’énergie et des matières premières |
| Ressources critiques | 💧 Eau douce, sols agricoles, forêts, biodiversité |
| Solutions proposées | 🌿 Transition énergétique, alimentation durable, agroécologie, mobilité douce, économie circulaire, sobriété, protection des écosystèmes |
| Exemples concrets d’initiatives positives | ✅ Villes zéro carbone, entreprises engagées dans l’économie circulaire, politiques publiques de reforestation |
| Objectif final | 🎯 Repousser la Journée du dépassement au 31 décembre (équilibre écologique) |